Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

Cet article vous est offert
Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous
Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ?
Inscrivez-vous gratuitement
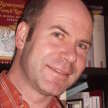
Pierre-Cyrille Hautcœur
Directeur d’études à l’EHESS
Entre-deux-guerres, de graves déséquilibres financiers ont entraîné des tensions commerciales qui ont renversé l’ordre international. Une période à méditer alors que les Etats-Unis s’avèrent aujourd’hui incapables de réduire seuls leur dette extérieure publique et privée, note l’économiste Pierre-Cyrille Hautcœur dans une tribune au « Monde ».
Publié aujourd’hui à 08h00 Temps de Lecture 3 min.
Article réservé aux abonnés
Les années 1930 sont quotidiennement citées, depuis la récente radicalisation protectionniste des Etats-Unis, comme l’exemple de référence du désastre qu’une montée aux extrêmes des rétorsions douanières peut engendrer. Mais la raison en est moins l’accroissement du niveau des droits de douane que le changement qualitatif du protectionnisme qui a lieu alors.
La loi Hawley-Smoot, votée en juin 1930 aux Etats-Unis, est souvent considérée comme le point de départ de la vague protectionniste. Elle accroît fortement les droits de douane sur de très nombreux produits. Elle s’explique cependant davantage par des actions de lobbying industriel exercées avant la crise que par la crise elle-même. Et certainement pas par la situation de la balance commerciale états-unienne, qui est constamment excédentaire depuis le début du XXe siècle. La loi Hawley-Smoot n’est d’ailleurs pas suivie d’une amélioration du solde commercial, les exportations baissant autant que les importations. En effet, de nombreux pays (dont la France) prennent des mesures de rétorsion.
Le deuxième moment-clé pour l’accroissement du protectionnisme est la crise financière aiguë qui frappe l’Autriche, l’Allemagne et la Hongrie au printemps 1931. Lors de cette crise, les capitaux américains investis en Allemagne pendant les années 1920 (au point qu’un historien a pu parler ironiquement de « réparations américaines à l’Allemagne ») se retirent, imposant la mise en place outre-Rhin d’un contrôle des changes sévère qui menace la place financière londonienne.
La Banque d’Angleterre choisit de protéger son système bancaire plutôt que de maintenir l’étalon-or : elle laisse la livre sterling flotter le 21 septembre 1931. Cette « dévaluation » est un choc inouï dans une économie mondiale où l’étalon-or était la foi la mieux partagée et la Banque d’Angleterre son grand prêtre. Elle est interprétée comme une mesure agressive (une dévaluation compétitive) par les partenaires du Royaume-Uni, qui se lancent alors dans une série de mesures protectionnistes qui, rétorsions aidant, accélèrent l’effondrement du commerce international.
Il vous reste 59.66% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois
Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Découvrir les offres multicomptesParce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.
Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).
Comment ne plus voir ce message ?
En cliquant sur « » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.
Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?
Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.
Y a-t-il d’autres limites ?
Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
Vous ignorez qui est l’autre personne ?
Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
Lecture restreinte
Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.